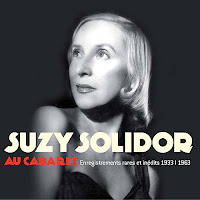« In Rainbows » en CD, ou Radiohead « réel »
Après-demain, 31 décembre, belle date de la nouvelle économie du disque et de ses déjà vieilles hypocrisies : In Rainbows sort en CD. Il y a quelques semaines, les confrères interviewant Radiohead jouaient les étonnés. N’avait-on pas juré que l’album serait diffusé uniquement sur internet à un prix fixé librement par les « acheteurs » (c'est-à-dire, bien souvent, rien) et en une version vinyle à tirage limité et à prix fort ?
A sa conférence de presse avant son concert à l’Olympia, le 22 octobre, Paul McCartney avait lâché une petite vacherie sur cette manière singulière de brader une œuvre au plus grand nombre et de tondre le fan le plus fidèle. Il sait de quoi il parle : depuis toujours (enfin, depuis OK Computer), Thom Yorke et ses petits camarades savent comme personne tondre le fan, notamment avec ces rafales de singles qui ne se différencient les uns des autres que par un titre live, un mix alternatif ou une nuance de couleur de la pochette. On a beaucoup daubé sur la fine nuance entre « relation privilégiée avec la fanbase » et « racket des gogos ». Un symbole ? Ce concert sinistre à Saint-Denis avec l’immense espace réservé devant la scène, sous le chapiteau, pour les invités et les membres du fan club, et quarante mètres plus loin, les payants qui se collaient aux barrières.
Voici maintenant que l’on parle avec une gourmandise goulue de ce revirement. Citons Les Inrockuptibles. Joseph Ghosn, tout ravi : « …quel que soit le format ou la manière de l’acheter, un album demeure avant tout cela : un moment de musique qui nécessite un investissement (financier, affectif) de la part de son auditeur. » Thom Yorke : « Nous n’aimions vraiment pas l’idée de travailler si dur sur un album et que les gens qui aiment la musique ne puissent pas en posséder un exemplaire, comme nos autres disques. » Ah ben voilà de belles vérités. Et si les internautes avaient décidé massivement de payer 30 livres à chaque téléchargement, en serait-on à enfoncer si bellement des portes ouvertes ? Une irrésistible irruption du réel face à l’effort de se concilier le monde virtuel. Une démonstration de réalité, en somme, passablement humiliante si l’on relit quelques-uns des papier de début octobre…
Donc voici maintenant la session de rattrapage pour les finances de Radiohead avec la sortie du disque « physique » en magasins, encore une fois à l’envers de la morale affichée par le groupe. Mais c’est une bonne occasion pour les fans les plus fidèles de dépenser leur argent. Ce sont eux qui auront payé le plus cher le disque sur internet, puis qui auront commandé l’édition de luxe (mise en vente avant l’annonce de la sortie en magasins « normaux »), puis qui l’achètent maintenant en CD. Hail to the thieves !